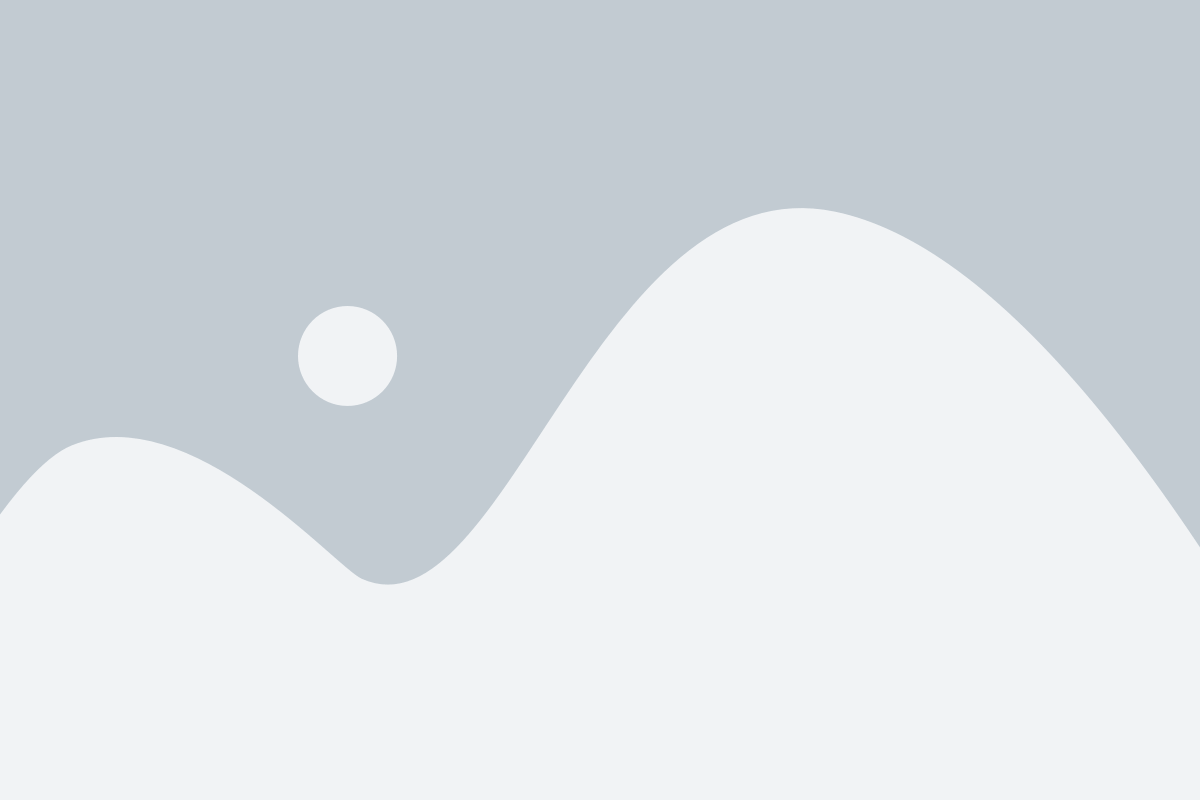Les sept saints fondateurs des Servites de la Bienheureuse Vierge Marie,
religieux à Florence au 14e siècle.
L’ordre des « Servîtes ou serviteurs de la bienheureuse Vierge Marie » date du XIIIè siècle. II prit naissance en Toscane.
La péninsule souffrait alors de factions rivales sans cesse aux prises. La nouvelle famille religieuse fut, semble-t-il, suscité du Ciel pour opposer au scandale de l’Injustice, de la violence, de l’insurrection, un exemple durable, singulièrement éloquent, de concorde, de désintéressement et de paix. En même temps, à la détresse causée par cet état de choses elle signalait ce recours aimable : la Vierge au cœur transpercé de glaive. Elle rappelait enfin le réconfort que la dévotion à la Pieta tenait à la disposition des éplorés.
Plusieurs personnages ont collaboré à la fondation.
Bonfils .Monaldi, Bienvenu Bonajuncta, Manet dell’Antella, Amédée des Amidel, Hugon des Uguccioni, Sostène des Sostegni, Alexis Falconieri étaient de riches commerçants florentins. Membres assidus et fervents de la célèbre et très ancienne confrérie des Laudesi, les « louangeur », ils se déterminèrent, au cours d’une réunion de piété, à répondre à l’appel de Dieu qui les invitait à renoncer au monde pour se consacrer au service de la Madone. C’était le jour de l’Assomption de l’année 1233.
Ils se libérèrent des servitudes de leur négoce pour vivre au service de l’Église, à l’image de la Mère de Dieu, dans la prière et dans l’apostolat, chacun réglant aussitôt sa situation de fortune et en distribuant l’argent aux pauvres. Ils étaient grands amis, ils avaient tous de trente à trente-cinq ans quand ils se retirèrent, silencieux, se construisant des huttes de bois dans la forêt aux portes de Florence, la villa Carmarzia, s’adonnant à la prière et au travail de leurs mains. A tour de rôle, ils prenaient la besace et se faisaient mendiants pour s’assimiler à la classe la plus pauvre et récolter beaucoup d’humiliations de la part de ceux qui se souvenaient de leurs richesses anciennes.
Là, leur « Dame et Maîtresse » manifesta le désir de voir ses fils dévots pratiquer une retraite plus rigoureuse. C’est pourquoi, à la fin de mai 1234, ils s’établirent sur le mont Senario, à trois lieues de la ville, pour mener désormais l’existence des ermites.
Un jour qu’ils allaient de porte en porte en mendiant leur pain, ils furent salués du titre de « Serviteurs de Marie » par une troupe de bambins. Une autre fois, des acclamations d’un même genre jaillirent spontanément, sur leur passage, des lèvres d’un nourrisson porté dans les bras de sa mère : il s’agissait là du futur saint Philippe Benizi qui devait entrer dans l’ordre, puis le gouverner en qualité de cinquième général. A la suite d’une révélation d’en-haut, le dominicain Pierre de Vérone confirma cette appellation gracieuse qui leur resta.
Le jour de la fête de l’Annonciation 1239, la Sainte Vierge intervint de nouveau pour fixer le but de leur vie religieuse et les moyens de l’atteindre. Elle leur apparut entourée d’anges, les uns portant les instruments de la Passion, un autre la Règle de saint Augustin, un autre présentant un vêtement noir complété d’un scapulaire. Marie leur expliqua que, revêtus de cet habit, et soumis à cette règle, ils devaient se consacrer non seulement à méditer, mais à prêcher les douleurs de la Passion de Notre-Seigneur et celles de sa sainte Mère. C’est aux PP. Servites que· l’Eglise doit l’institution de la dévotion à Notre-Dame des Sept Douleurs.
C’était la vie mixte avec en fait d’apostolat un programme d’enseignement, de prédication, de missions, de service paroissial.
Ils n’avaient jamais songé à fonder un ordre de religieux, mais Rome le leur imposa et ce fut leur dévotion à la Sainte Mère de Dieu qui leur fit donner le nom de « servites » ou « serviteurs de Marie. »
Ils comprirent que le sacerdoce était une condition nécessaire pour assurer le succès de leur ministère. Tous se préparèrent à l’ordination sacerdotale, sauf Alexis Falconieri, qui insista pour demeurer dans l’humble rang des frères laïcs.
En 1243, Ils commencent à essaimer et sortent de leur retraite, se répandent bientôt à travers l’Italie et en dehors de ses frontières, et deviennent pour l’Eglise un ferment nouveau de sainteté.
Ils fondent tour à tour les couvents de Pistole, de Sienne, d’Arezzo. L’année suivante, les supérieurs de chaque maison se réunissent en un premier chapitre à l’issue duquel Bonfils Monaldi est élu prieur général de l’ordre. En 1256, le pape Alexandre IV renouvelle l’approbation provisoire de l’Église. Elle deviendrait définitive en 1304, de par un décret de Benoît XI.
Manet dell’Antella, dès l’année 1265, se trouva en mesure d’envoyer en Asie Mineure un premier effectif de missionnaires. A dater de là, si l’on excepte quelques interruptions qui tiennent au recrutement de l’Institut, l’évangélisation des infidèles figurera toujours chez les servites le ministère de choix, consacré au demeurant par de nombreux martyrs. Leur liste glorieuse va du bienheureux Antoine de Viterbe (t 1309) au P. Ignace Mayr torturé pour la foi en 1914. Enfin, au XVè siècle, le souverain pontife Martin V classa l’ordre parmi les mendiants.
Tous revinrent terminer leur vie dans la solitude du mont Senario, à l’exception d’Alexis Falconieri, qui vécut jusqu’à 110 ans et mourut à Florence. Le premier qui fut rappelé à Dieu fut Buonagiunta Manetti : le 12 août 1251, après avoir célébré le saint sacrifice, il annonça sa fin prochaine. Puis, comme c’était un vendredi, selon l’usage, il commença à commenter le récit de la Passion. Arrivé à ces mots : « Ils le crucifièrent », les larmes jaillirent de ses yeux ; il étendit les bras en croix, et au moment où il répétait les paroles de Jésus expirant « Père, je remets mon âme entre vos mains », il expira.
Epilogue
Léon XIII, en 1888, les canonisa collectivement sous les noms de Bonfils, Bienvenu, Manet, Amédée, Hugues, Sosthène, Alexis. Leurs corps sont ensevelis au Mont Senario, dans le même sépulcre, afin qu’une même châsse conserve, une fois morts, ceux que la vie fraternelle avait unis.
Ils sont commémorés ensemble le jour où serait mort centenaire le dernier d’entre eux, Alexis, en 1310.
Aujourd’hui, les derniers recensements dénombrent 85 couvents.
L’Italie en a 43. Le reste se répartit entre les États de l’Europe centrale, les Iles Britanniques, les États-Unis, le Canada. En plus de ses deux résidences de Bruxelles et de Spa, la Belgique possède le collège International de Louvain. En France, plusieurs Pères desservent, au diocèse de Versailles, la paroisse de Saint-Gratien ainsi que la chapelle publique de la rue de Pontoise à Montmorency. Enfin sont confiées à l’ordre plusieurs missions étrangères : dans le Sud-Africain, le vicariat apostolique du Swaziland, en Argentine et au Brésil, la prélature nullius du Haut-Acre et du Haut-Purus dans les territoires de l’Amazone.
Par privilège, les servites de Marie fournissent à la famille pontificale son confesseur. Ils ont la direction et l’administration de l’archiconfrérie de Notre-Dame des Sept-Douleurs.
L’habit distinctif, de couleur noire, se compose d’une tunique, d’un scapulaire, d’un capuce et d’un manteau. La ceinture est de cuir.
La famille admet des convers. Elle agrège aussi des tertiaires séculiers. Elle comporte par surcroît des communautés de femmes. Les unes sont cloîtrées ; les autres mènent la vie mi-contemplative, mi-active. La création de ces dernières est attribuable à la nièce de l’un des sept fondateurs : sainte Julienne Falconieri. Elles participent du même esprit, observent les mêmes constitutions que les Pères. Pour elles l’apostolat s’exerce dans les pensionnats, les patronages, les ouvroirs, auprès des pauvres et des malades. Mais, elles s’appliquent d’abord à « fixer le regard sur Marie, la toute belle, l’Immaculée, la Mère de Dieu et la Mère des hommes, surtout sur la Vierge dolente, reine des martyrs. »
* * *
Ô vous qui passez, voyez s’il est une douleur comparable à la mienne !
Vierge très douloureuse, priez pour nous, afin de nous rendre dignes des promesses de Jésus-Christ.