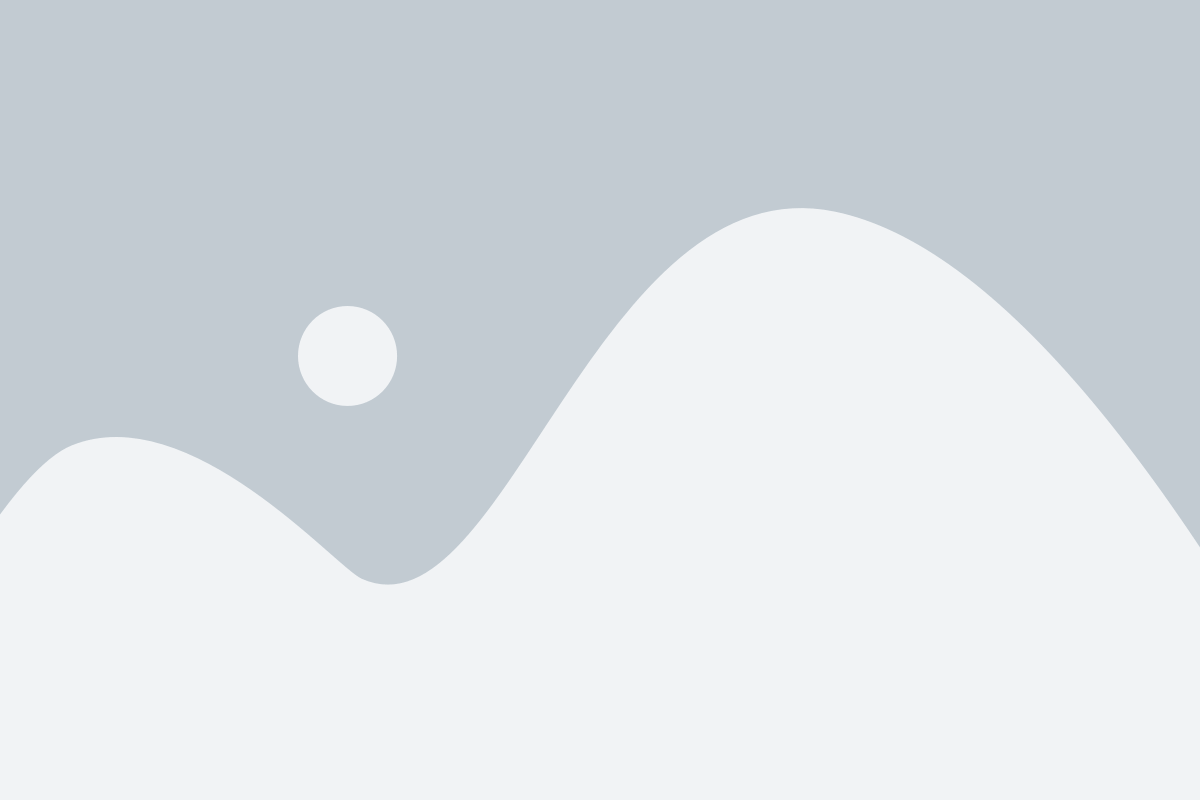La défense de la foi pratiquée par l’apologétique a toujours dépendu des objections, mais l’incroyance n’est plus ce qu’elle était. D’où la question soulevée par l’essayiste Jean Duchesne, cofondateur de la revue de théologie « Communio » : quelles opportunités offre une situation où la priorité n’est plus de prouver l’existence de Dieu ?
Par les temps qui courent, où le christianisme et l’Église sont loin d’avoir toujours bonne presse, l’apologétique, c’est-à-dire la défense et illustration de la foi, devrait être un genre florissant. Or ce n’est pas le cas, comme le constate et y réfléchit, dans un essai récemment publié au Cerf, Emmanuel Falque, doyen honoraire (bien que pas encore à la retraite) de la Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris. Cette désaffection vient, explique-t-il, de ce qu’au cours des dernières décennies, l’incroyance a changé : elle ne prend même plus la peine de nier l’existence de Dieu. La sécularisation fait qu’on n’y pense même plus, de sorte que, dans les mentalités, il ne reste pas d’ »objet » concevable à discuter, que ce soit pour le critiquer ou pour le justifier. Un tel diagnostic débouche sur un défi.
D’illustres prédécesseurs
Dans cette Nouvelle Lettre sur l’apologétique, Emmanuel Falque, déjà auteur d’une vingtaine de travaux qui lui ont valu une réputation universitaire au-delà de nos frontières, se situe d’emblée vis-à-vis d’illustres prédécesseurs : Maurice Blondel (1861-1949) et sa Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine en matière d’apologétique et sur la méthode de la philosophie dans l’étude du problème religieux (1896) ; et Henri de Lubac (1896-1991) avec son Drame de l’humanisme athée (1944). Le premier écrivait au moment où émergeait, à côté d’un scientisme matérialiste, un modernisme encore spiritualiste, et le second montait au front face au déchaînement des idéologies nazie et marxiste.
Selon l’auteur de cette Nouvelle Lettre (qui affiche un catholicisme sans réticences ni complexes), l’argumentation développée il y a déjà 130 ou 80 ans n’est désormais guère convaincante. Elle repose en effet sur l’a priori que réside invinciblement en tout être humain une aspiration à une transcendance. Subsisterait donc, au sein de la nature (et prêt à affleurer dans la conscience humaine), un « surnaturel » qui serait comme le sceau du Créateur. Cela paraît un ajout artificiel et des plus contestables dans la perspective de l’humanisme actuel : sans au-delà, où la vie n’est qu’un « être-vers-la-mort » (selon une formule de Heidegger — et si l’on ose cette simplification de béotien, qui n’est ici ni la première ni la dernière).
Henri de Lubac et Michel de Certeau
La solution proposée in fine par Emmanuel Falque est l’écoute de ceux auxquels s’adresse l’apologétique et le dialogue avec « la culture et l’art contemporains » — les sciences dites humaines notamment. L’idée n’est plus de prouver aux non-croyants la vérité chrétienne (y compris sur eux-mêmes) qu’ils méconnaissent. Il s’agit plutôt de découvrir comment la foi est perçue, puis d’essayer de compléter et corriger cette image, pour autant qu’elle est faussée — et de l’intérieur non moins que par le regard porté du dehors, puisque ce qui paraît est trop souvent défiguré du fait qu’on s’en empare au lieu de s’y conformer en le partageant.
Cette séduisante démarche se réfère à Michel de Certeau (1925-1986), jésuite spécialiste du mysticisme, féru de psychanalyse et enthousiaste de Mai 68. Il se proclamait redevable à Henri de Lubac, et celui-ci le désavoua. Ce différend n’a guère retenu l’attention et s’inscrit dans le cadre des débats sur Vatican II : rupture salutaire ou opportun recentrage ? L’aîné reprochait au plus jeune de « croire ne rien pouvoir accueillir de neuf que par le rejet de l’ancien » — comme si l’Esprit saint s’absentait parfois, ou comme si, pour rester crédible, l’Église devait non pas se ressourcer dans la dynamique sans discontinuité sa Tradition, mais repartir sans cesse de zéro et répudier son passé pour désarmer ses détracteurs et répondre à leurs attentes.
De Justin martyr à C.S. Lewis
Il est sûr que l’apologétique a toujours tenu compte des objections qui la motivaient. Ainsi, saint Justin au IIe siècle ferraille avec les pensées grecque et juive. Blaise Pascal propose son pari aux « libres penseurs » de son temps, passionnés par les jeux de hasard. Dans son Génie du christianisme, Chateaubriand mise sur l’importance que les Lumières ont accordée au sentiment (en contrepoids de la raison) et sur l’esthétique qu’est en train de développer le romantisme. En Angleterre, saint John Henry Newman réplique par son Apologia pro vita sua aux critiques de sa conversion. En revanche, Chesterton et C.S. Lewis ne sont pas sur la défensive : ils confortent les croyants désorientés par le scepticisme ambiant, en soulignant combien la foi est cohérente, raisonnable et même libératrice.
On voit là que l’apologétique ne se cantonne pas dans la sphère profane et spécialisée de la philosophie, au niveau spéculatif des « preuves » que Dieu existe et de l’anthropologie. Il faut toutefois noter que la cloison entre théologie et philosophie est devenue poreuse dernièrement. La « modernité » a longtemps estimé que l’événement de l’autorévélation forcément unilatérale du Dieu unique, personnel et transcendant, créateur et sauveur, enfermait la première dans un ghetto isolé du champ ouvert de la seconde. Les Pères de l’Église et les scolastiques médiévaux avaient pourtant bien saisi que cette irruption, loin de paralyser la pensée, la stimulait.
Au fil de l’histoire de la philosophie
Après que Descartes, Kant et Hegel ont tenté de refonder le christianisme, Marx, Nietzche et Freud ont voulu évacuer le Dieu que l’intelligence occidentale avait reçu de la Bible, et pas inventé. Mais au XXesiècle la percée de la phénoménologie a trouvé de l’intérêt aux concepts théologiques. Simultanément, la théologie s’est recentrée sur la Révélation qui, en philosophie, a des retombées mais pas de sources. Un rapprochement sans absorption ni exclusion a ainsi pu s’opérer. Emmanuel Falque l’a bien vu, dans un essai significativement intitulé Passer le Rubicon (Lessius, 2013 ; réédition Cerf, 2023). Dans sa Nouvelle Lettre, il a conscience de ne faire que de suivre Levinas, Ricœur, Michel Henry, Jean-Louis Chrétien, Jean-Luc Marion, Jean-Yves Lacoste…, en se colletant avec les positions d’incroyants sans concessions : Merleau-Ponty, Deleuze, Foucault, Derrida, Jean-Luc Nancy…
La philosophie n’est peut-être toutefois pas le terrain décisif pour l’apologétique, car les dénis affrontés à présent portent d’abord sur l’Église visible : son influence, les contradictions entre ses idéaux et la conduite de sa hiérarchie ou de certains fidèles… Sans remonter jusqu’à Dieu, on dénonce au nom de la laïcité le « fait religieux » comme une inépuisable source de superstition, d’intolérance, d’oppression et de violence, à colmater autant que possible dans l’espace public, en attendant qu’elle se tarisse sous l’effet du Progrès ou des lois de l’évolution.
Restaurer la crédibilité de la foi
Ce préjugé hostile n’autorise aucune discussion, et ne se laisse ébranler ni par les exigences de la liberté de conscience, ni par la vitalité de la religiosité hors d’Europe, ni par les cultes substitutifs qui se multiplient en Occident et font paraître supportables les religions instituées — en particulier le christianisme, qui promeut l’ »autonomie du temporel ». Il existe pourtant un réalisme qui garde ses distances tout en trouvant à la foi quelque intérêt et même des mérites.
Un exemple est l’écrivain espagnol anticlérical Javier Cercas. En suivant le pape François en Mongolie, et en en faisant un récit honnête dans Le Fou de Dieu au bout du monde (Actes Sud, septembre 2025), il a contribué à restaurer la crédibilité de la foi. C’est peut-être là le dialogue préconisé dans cette Nouvelle Lettre. Ce qui n’empêche pas tout croyant d’avoir (en se sachant aussi faillible que responsable) à soigner l’image de l’Église — sans oublier que le Christ qui s’y rend accessible reste jusqu’à son retour signe de contradiction (Lc 2, 34), et que l’apologétique ne saurait consister à se barricader derrière les portes qu’il a ouvertes (Ac 14, 27).
Pratique :
Nouvelle Lettre sur l’apologétique, Emmanuel Falque, Cerf, octobre 2025, 160 pages, 16 euros.
ALETEIA